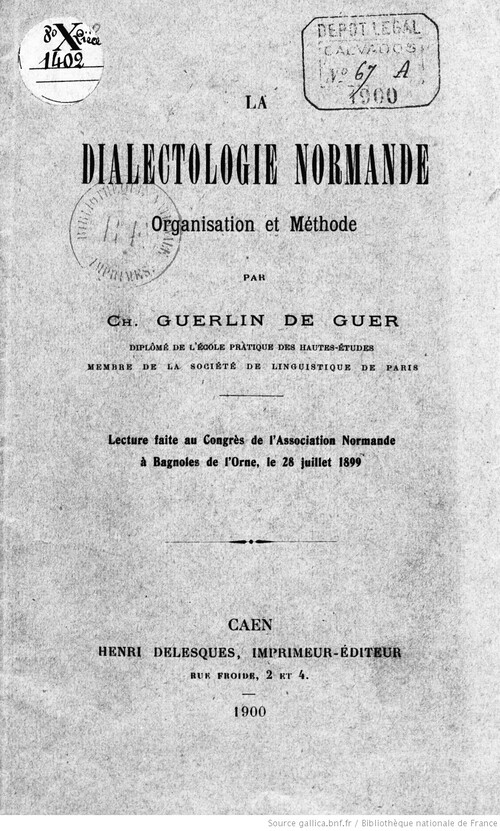-
Par cgs611 le 27 Mai 2021 à 16:09
MON PROCÈS EN COUR D'ASSISES..
PAR
J. B. L. GUESNON
~*~
Depuis long-temps, une petite société de Lexoviens, qui m'ont voué la haine la plus cordiale, attendaient avec impatience le moment où, à tort ou à raison, ils pourraient, de quelque manière, mettre la main sur moi.
Pendant l'interruption du Patriote, que j'espérais voir relever bientôt, je fis paraître une feuille mensuelle, et je la signai. Le but de mes adversaires était atteint. Richelieu avait besoin pour faire pendre un homme, de cinq lignes de son écriture ; le parquet en demandait moins, il ne lui fallait qu'une seule signature.
A la première signature je fus donc poursuivi. M. le procureur-général Berthaud m'apprit, par l'organe de M. Bardou, huissier à Lisieux, que j'avais offensé la personne du roi (personne dont je ne m'occupe guères, en vérité), et que j'excitais à la haine et au mépris du gouvernement du roi ; légères peccadilles que l'on punit par cinq ans d'emprisonnement et dix mille francs d'amende.
A la nouvelle de cette poursuite inique et ridicule, tous les honnêtes gens furent indignés, mais la coterie claqua des mains et fit éclater sa courte joie dans le Normand, aboyeur à gages de la société guizotière ; ils me croyaient déjà ruiné par les amendes et condamné à pourrir pendant quatre ou cinq ans sur la paille des geôles. Dans sa jubilation, la feuille de la police occulte ajoutait qu'outre le gouvernement j'avais encore offensé LES LOIS.
Au premier abord, cette étonnante poursuite me causa une bu pression désagréable. J'étais parfaitement sûr de mon bon droit, mais une erreur était possible et mon avenir en dépendait !!!.. Toutefois, il me fallut à peine un jour pour me familiariser avec ma position qui, on me croira si l'on veut, n'était pas sans charmes. Je me sentais un petit grain de vanité, en pensant que j'allais recevoir le baptême de ma foi politique. Celui-là est indigne de se dire ami de la SAINTE-CAUSE, qui ne sait pas, à l'occasion, souffrir pour elle. Mes ennemis, par leur fausse manœuvre, s'étaient mis dans cette alternative, ou d'échouer, et c'était pour moi un triomphe ; ou d'obtenir par surprise une condamnation révoltante d’injustice, et alors en succombant, je servais la cause.
Bien des patriotes à l'eau rose ne comprendront pas ce sentiment, et prétendront qu'il n'y a jamais d'avantage à être poursuivi, et encore moins à être condamné : à chacun sa manière de voir. Je répondrai à ces gens, qu'avec leur raisonnement de colimaçon, ils eussent été désorientés et bouleversés là où je n'ai pas perdu mon calme une seconde : que vingt millions d'honnêtes trembleurs n'arrêteraient pas la guizolâtrie à une seule de ses fredaines, tandis que mille hommes de tête et de cœur feraient reculer le système réacteur dans huit jours. Puis, il est bon de montrer qu'il existe des gens qui ne sont ni peureux ni égoïstes ; cela rassure pour l'avenir.
Le dimanche, 12 février 1837, dûment nanti de ma citation et de ma liste de jurés, je me mets en devoir d'obéir au citoyen Berthaud et je m'achemine vers Caen, où je devais comparaître, au palais de justice, le 14, à huit heures du matin. A huit heures du matin, heure militaire, j'arrive au palais ; mais là je compris que parole d'assignation n'est pas parole d'évangile, A dix heures, arrive l'affaire ; mais l'avocat-général, M. Massau n'arrive pas ; on suspend jusqu'à onze heures, pas de Massau ; on remet à deux heures, à deux heures, personne : cela devenait intolérable.
La cour alors, considérant que M. l'avocat-général est malade, renvoie à vendredi. Inutilement je fais observer que c'est me mettre à l'amende avant que je ne sois condamné; que pour moi l'absence est funeste, le séjour ruineux. On entend tout cela, et l'on remet à vendredi à neuf heures. « Cette fois, ajoute M. le président, c'est très-sûr. Si M. Massau est encore malade, un autre membre du parquet parlera. »
Les honnêtes coteriers de la guizolâtrie locale, n'ayant rien de pis à faire, profitent de ce délai pour répandre les bruits les plus absurdes. Selon les uns, j'étais condamné à 1,500 cents francs d'amende et un an de prison ; si je ne revenais pas, c'est que j'étais déjà sous clé. D'autres assuraient que je ne pouvais trouver un défenseur. Notez qu'il n'y a pas un accusé qui ne puisse choisir dans tout le barreau de Caen.
Pendant que ces rumeurs circulaient à Lisieux, une partie de la jeunesse caennaise, et surtout l'école de droit en masse, manifestaient le plus vif intérêt pour le succès d'une cause, où il s'agissait de défendre un des derniers lambeaux de notre liberté. Les patriotes caennais me donnaient des preuves de la plus vive sympathie, et un membre du barreau, entre autres, m'a offert son assistance avec autant de délicatesse que de générosité. Il n'était pas jusqu'à la classe ouvrière qui ne s'intéressât à l'issue de ce procès.
Le vendredi, de retards en retards, on attendit jusqu'à plus de trois heures du soir. M. Massau était toujours malade. De guerre lasse pourtant on consentit à confier l'attaque à un substitut, M. Lantaigne, et l'affaire s'engagea. Au tirage des jurés, l'attaque n'exerça aucune récusation ; la défense en fit autant et le sort décida de mes juges ; puis M. Lantaigne prit la parole et formula son réquisitoire.
Le Pilote de Caen a cru devoir glisser à M. l'avocat du roi, un petit compliment tout galant, sur son éloquence et son talent digne d'une meilleure cause. Il est probable qu'alors un nuage mystérieux m'aveuglait, car j'ai trouvé l'éloquence et le talent de M. l'homme du parquet tout juste à la hauteur de la cause. Son débit d'abord gêné, empêtré, haché, vaguant à droite et à gauche, n'a pris à la fin un peu d'ordre et de suite que pour redire de vieilles phrases, qui traînent depuis six ans dans tous les discours ministériels et parquétiques. Dans ce réquisitoire, qui a duré une demi-heure environ, je n'ai remarqué que trois simplicités caractérisées ; les voici en substance.
Première simplicité. « Messieurs, je n'ai pas eu le temps d'étudier la cause : mais en pareille circonstance le délit doit frapper les yeux et jaillir aux regards.... »
Donc ce n'était pas la peine de me retenir quatre jours, sous prétexte que M. Massau avait seul étudié la cause, puisqu'il n'était pas besoin de l'étudier.
Deuxième simplicité. « Le délit d'offense n'est peut-être pas formellement exprimé ; mais on reconnaît qu'il est dans l'intention de l'auteur. »
Or, ce sont les actes faits et exprimés que l'on juge, et non les intentions.
Troisième simplicité. « Si messieurs les jurés ne trouvent pas dans cet article le délit d'offenses envers le roi, au moins y trouveront-ils l'excitation à la haine et au mépris du gouvernement. » Nous verrons, après le plaidoyer, comment M. Bayeux a relevé la simplicité.
Après le réquisitoire, on nous menaça d'une remise à l'aprèsr dîner : c'était la cinquième ; cependant, nous en fûmes quittes pour la peur et, par la permission de la cour, le prévenu fit entendre sa défense en ces termes :
MESSIEURS,
Je ne sais trop comment débuter. C'est un étrange embarras que de se trouver ainsi subitement, à l'improviste, transformé en criminel, surtout quand on n'en a pas l'habitude.
Quand, il y a six semaines, j'écrivis les quelques lignes où la lunette de M. le procureur général a découvert je ne sais plus déjà quel crime, tout à fait invisible à l'œil nu, en vérité, je ne me doutais pas qu'un jour il me faudrait venir ici, en pleine cour d’assises, rendre compte de ces quelques lignes, je ne dirai pas échapées à ma plume, mais châtiées avec une sévérité dépassant toutes les bornes. Quand je dis que mon travail était sévèrement châtié, ce n'est pas quant au stile et à la forme extérieure de la phrase, mais bien quant au fond, quant à la pensée, quant à l'innocence de la doctrine.
On demandait un jour à Ésope où il allait : je n'en sais rien, répondit-il. En effet, on le conduisait en prison, où bien certainement il ne croyait pas aller. Parole sage, et que j'aurais pu répéter naguères. Car, au moment où je jetais les phrases de l'article incriminé, si l'on m'eût demandé ce que je faisais, bien certainement, sans le vouloir, j'aurais répondu par un mensonge. Avec la plus grande sécurité de conscience, je pensais défendre les intérêts du pays et la majesté des lois hélas ! je commettais, un délit, un crime je pense ; j'offensais la majesté royale, et j'excitais à la haine et au mépris du gouvernement ! Je croyais parler contre les abus, je parlais contre l'article 4 et l'article 9. Accordons pour un moment que je sois un criminel , un grand coupable, puis qu'on le veut absolument ; mais sérieusement je ne devais guères m'y attendre, et si quelque esprit à mauvais augure s'était ingéré de me le dire, très-certainement j'aurais réclamé pour lui une place au Bon-Sauveur. Voyez pourtant où nous mène de ne pas croire à l'impossible ! Mon prophète de malheur ne serait pas à l’hôpital, et moi je suis à la cour d'assises.
Afin d'apprécier clairement la non culpabilité des lignes incriminées, plaçons nous bien dans la situation où elles ont été écrites.
Depuis la mi-décembre, l'absence du gérant du Patriote, la nécessité où l'on était d'opérer le transfert du cautionnement força les bailleurs de fonds à retirer ce cautionnement. La loi exigeant que le cautionnement retiré restât libre pendant trois mois, il fallait, pendant ce laps de temps, ou former un nouveau cautionnement, ou suspendre la publication du Patriote. De ces deux mesures, la première était impossible, la seconde ruineuse. On sait que notre feuille n'a pas de fonds secrets pour la soutenir ; le timbre, la poste rendent les frais écrasans , un petit journal de province n'est jamais riche ; les bailleurs de fonds étant fatigués, il était impossible de leur demander encore 7,500 francs. D'un autre côté, la suspension du journal pendant trois mois perdait la clientelle et ruinait sans ressource un établissement d'imprimerie qu'il soutient. Dans cette pénible alternative, je voulus, par pur dévouement, et sans un centime d'intérêt, créer, pour les abonnés du Patriote, un journal mensuel consacré à la politique, dans l'espoir que cette feuille, en entretenant la correspondance, conserverait, en partie du moins, la clientelle du Patriote. Alors je fondai, pour trois mois seulement, la feuille intitulée l'Ami des Patriotes. Un cautionnement n'était pas nécessaire, et quant à éviter les poursuites j'avais un moyen que tout autre avec moi aurait regardé comme infaillible. Depuis deux ans et demi je rédige le Patriote, et ce journal n'a pas été poursuivi. Or, me disais-je, en suivant la même route, en augmentant encore de précautions, en dépassant toutes les bornes de la prudence, pour ne pas laisser même l'ombre d'un prétexte, bien certainement le parquet ne me troublera pas. Précaution vaine à ce qu'il parait. M. le procureur général s'est chargé de me faire voir que l'innocence la plus évidente ne met pas à l'abri d'une poursuite, et qu'il n'est pas un homme tenant la plume, quels que soient d'ailleurs ses actes et ses intentions, qui puisse se dire : « Je n'irai pas à la cour d'assises. »
En effet, que peut faire, à votre sens, l'écrivain le plus innocent, le plus fermement résolu à éviter tout démêlé avec la justice ? Défendre l'intérêt du pays ? je l'ait fait. N'imputer qu'aux ministres responsables tout ce que l'on peut blâmer dans le système gouvernemental ? je l'ai fait. Respecter la personne du roi, la mettre nettement, formellement, explicitement en dehors de toutes les discussions ? je l'ai encore fait. Respecter les lois, en réclamer chaudement, énergiquement l'exécution ; j'ai fait tout cela, vous dis-je, j'ai fait mieux encore, et je suis sur le banc des accusés ! Pour redire ici une de ces phrases qui ont choqué le ministère public : « C'est incroyable, mais c'est vrai. » Il est difficile d'en douter. Mais, dit l’accusation, ce n'est pas tout d'affirmer, il faut prouver. Prouver cela ! à l'instant même ! Rien n'est plus facile, en vérité. Cela se prouve comme le soleil : on le montre. Notre vérité rentre dans la cathégorie des évidences.
L'article, intitulé Discours du trône, est incriminé pour offense à la personne du roi. Si j'avais été procureur général et déterminé à porter contre l'Ami des Patriotes une accusation semblable, au moins j'aurais essayé de la loger quelque part ailleurs. L'article en question est mal choisi, très mal choisi, car il porte en lui même la plus formelle réfutation à l'accusation dont il est la base.
J'ai parlé tout à l'heure des minutieuses précautions que j'avais prises pour ôter tout prétexte aux poursuites. Que Messieurs les jurés n'aillent pas croire que j'ai voulu en imposer par une figure de réthorique ; j'ai énoncé une vérité toute simple et toute unie. Dans le numéro du cinq février, il n'est pas une colonne qui n'en fournisse une preuve. C'est ainsi que pour l'article de vingt lignes que l'on accuse, j'ai écrit un préambule de 19 lignes que voici.
« DISCOURS DU TRÔNE… »
« On nous demandera peut être pour quoi nous ne disons pas : Discours du Roi ! Nous répondrons qu'il y a une loi qui défend de faire remonter jusqu'au roi la moindre responsabilité ; que cette loi n'est pas connue de nos ennemis, mais que pour nous, on sait bien nous la rappeler. En conséquence, pour obéir à cette loi, et dans la crainte respectueuse de l'amende et de la prison , nous déclarons formellement que nous attribuons, tout aux ministres, que la personne de Louis-Philippe est en dehors de toutes nos discussions, et que si, par inadvertance , le mot roi nous échappait, nous déclarons n'entendre par ce mot que la personnification idéale du cabinet ministériel. Nous portons notre respect de la loi, des procureurs et des gendarmes à tel point, que, si nous étions forcés de parler des bottes ou du chapeau du roi, nous consentirions à dire les bottes du système et le chapeau du cabinet. »
Cela doit paraître passablement clair. Dans ma condition de professeur, je me trouve à lutter parfois contre des natures bien ingrates, des intelligences bien obtuses ; je n'en ai pas rencontré encore, qui pussent résister à des explications aussi nettes, aussi formelles. Maintenant que l'intention est parfaitement connue, explicitement manifestée, n'aurais je point, par hasard, manqué involontairement à la règle que je m'étais tracée Voyons.
« Le discours de la couronne est aussi nul et aussi faux que tous les discours analogues passés et futurs. On y voit toujours la paix universelle à côté de nos désastres d'Alger, de la guerre d'Espagne, des mouvemens de l'armée russe, et d'autres petits faits tout aussi pacifiques. Comme de raison, le calme renaît de plus en plus ; il en fait autant depuis six ans, témoins les complots et les tentatives de régicide. Une chose cependant se distingue dans ce discours ; c'est l'annonce indirecte d'une demande qui sera faite aux chambres. Il s'agira de voter une dot à la fille aînée de Louis-Philippe. Si j'avais 36 millions de revenu, je ne demanderais à personne à doter mes filles. Mais le système pense autrement. Vous verrez, si Dieu leur prête vie, qu'il faudra doter les filles des ministres, et payer les chevaux des fils des préfets. Prenez toujours, messieurs de la doctrine ; la France est une bonne vache à lait. Il y a des gens qui meurent de froid et de faim. Qu'importe ? »
Il est de toute impossibilité de trouver là rien qui s'adresse au roi, à moins que l'accusation n'appelle le roi des Français, Monsieur de la doctrine ; libre à elle, mais moi je ne donne pas de noms dans ce genre là. Par la doctrine, et le système doctrinaire, j'entends le ministre Guizot et ceux qui administrent avec lui, j'entends le système de ces gens dont aucun n'est roi des Français, qui ne sont que ministres, et qui, je l’espère, ne le seront pas toujours. Voilà les gens à qui je m’adresse, et que je blâme. Pour le monarque, je l'ai dit et je tiens ma parole, je le laisse en dehors de toute discussion.
Mais vous parlez du roi, des filles du roi.... Sans doute. Mais qu'est-ce à dire ? On en parle tous les jours, à toute heure et partout. Est-ce à dire pour cela qu'on l'offense ? Non vraiment. Car le roi dans tout article semblable est l'objet de la discussion, la matière, le motif sur lequel la plume s'exerce, mais il n'est le but ni de l'éloge ni de la critique ; je blâme, j'offense peut-être à l'occasion du roi, en parlant du roi, mais ce sont les ministres que je blâme, et non pas celui qui règne. —J'ai parlé du roi. Oui vraiment. J'ai parlé aussi des princesses, puis des filles des ministres, puis des fils des préfets, Ai-je offensé tous ces gens là ? Pas le moins du monde. Chacun d'eux peut-être individuellement fort respectable ; mais j'ai critiqué le système ministériel, qui prodigue l'argent des contribuables pour des dépenses mauvaises et généralement blâmées, quand il en est d'autres si utiles ; que l'on néglige. On trouve coupable cette phrase. « Si j'avais 36 millions de revenu je ne demanderais à personne à doter mes filles. » Cette phrase, simple, triviale en elle même n'a un sens que quand on la complète. L'accusation en tire ainsi la conséquence. « Donc Louis Philippe qui a trente six millions de revenu a tort de deman der une dot pour ses filles. » Cette manière de conclure est peu charitable ; heureusement elle n'a pas le sens commun. En effet, part toute fiction constitutionnelle, dont je pourrais me prévaloir, et pour ne m'appuyer que sur la simple vérité, sur la vérité de fait, il n'est pas vrai de dire que Louis-Philippe a demandé… Ce sont les ministres, et non le roi.
Je pourrais ainsi suivre l'accusation phrase à phrase, et partout nous retrouverions la même conclusion, frappante, inévitable ; car elle est au fond même de la question. Au lieu de discuter ainsi pied à pied et en détail, en livrant un combat d'escarmouche, propre seulement à fatiguer la cour et le jury, mieux vaut de suite trancher dans le vif et aborder au fond de la question.
J'ai critiqué, blâmé le discours d'ouverture, je le reconnais hautement. En critiquant l'œuvre en ai-je critiqué les auteurs ? sans aucun doute. Quels sont ces auteurs ? le roi ? Non. le ministère ? Oui. Dans ces quatre mots repose toute la question. Question vaste, immense ; question qui touche aux bases de l'édifice constitutionnel, de l'avenir de la liberté. C'est ici que je prie messieurs les jurés de me continuer leur bienveillante attention. Une tendance bien funeste à mes yeux, se révèle chaque jour par de nombreux et tristes symptômes ; tendance funeste qui en se développant sans cesse aboutirait à faire croûler le trône, et à renverser l'édifice de la société.
Un principe sacré, inattaquable dans l'évangile constitutionnel, c'est que le roi ne peut mal faire. Eh bien ! ce principe salutaire, cette maxime conservatrice, ce gage précieux d'ordre et de stabilité dans l'existence sociale, il s'est trouvé des hommes, malédiction sur eux ! qui ont voulu le jeter au visage de la nation française, comme une amère et insultante dérision ! Des hommes qui, pour un intérêt de caste, un égoïsme de parti, de famille, de coterie, jouent imprudemment avec la foudre, et sèment des flammes sur la mine qui peut s'embrâser. Le roi ne peut mal faire, dit la loi : et pourquoi cela ? c'est que jamais on ne devra attribuer au roi de ces doctrines éphémères, de ces théories passagères et changeantes, de ces systèmes faux, ridicules, désastreux quelquefois, que chaque ministère apporte et emporte avec lui. Ces doctrines, ces théories, ces systèmes, passent, reviennent, passent encore, se succèdent, se heurtent, se combattent, se brisent, meurent les uns à la suite des autres, tandis que, placé au-dessus de ces orages, le trône, comme la vérité, est là, toujours debout toujours le même. Aux ministres ce qui est variable, passager, contestable, sujet à critique et à discussion. Au roi ce que personne n'a le droit de contester, l'honneur du nom français, la charte, la Loi.
Mais cette position inférieure, dépendante, précaire, il est des hommes qui ont trop d’orgueil pour l’accepter ; leur vanité se révolte à l'idée d'une contradiction ; leur suffisance s'indigne d'une attaque ; irrités de voir censurer leurs actes , ils en ont impudemment chargé la responsabilité du roi ; repoussés par la nation qui s'en défie et les méprise, sentant le terrain mal solide croûler sous leurs pas, honteux de leur triste isolement, de leur nudité difforme, ils ont voulu s'appuyer sur les marches du trône et se cacher dans les plis du manteau royal : s'accrochant ainsi des dents et des ongles à un royauté qu'ils n'ont pas fondée, voulant s'assimiler à une monarchie qui n'est pas la leur, à l'ombre des glorieuses couleurs qu'ils brûlaient naguères et qu'ils détestent encore , ils ont cru se rendre stables comme le trône, durables comme la monarchie, glorieux comme notre noble étendard. En vérité, leur orgueil les a bien trompés ! On les arrache de ce piédestal qu'ils veulent usurper, et on les montre couverts de boue à la risée de chacun. S'ils se cachent sous la pourpre des rois, une main écartera la pourpre des rois, et le ministre audacieux sera justement châtié.
Mais, ce n'est pas tout, messieurs les jurés ; non seulement le discours du trône appartient de droit et constitutionnellement aux ministres ; non seulement ce compte-rendu de politique, cet exposé de système que l'un trouve bon, l'autre mauvais, rentre, par sa nature discutable et sujette à contestation, dans les attributions spéciales d'un ministère responsable ; mais, de plus, en fait et par la vérité matérielle et physique, le discours d'ouverture est un œuvre de cabinet, œuvre long-temps débattue, délibérée en conseil ; programme de session où chaque ministre a intercalé sa phrase ou son paragraphe ; qui la tranquillité de l'intérieur, qui la non-intervention , qui de la marine, qui des finances. Puis, quand ce tout de phrases, parfois incohérentes, fausses et pis encore, a été réuni et lu devant les chambres, vous voudriez appeler cela l'œuvre du roi ? ah ! cela n'est pas possible. Si quelqu'un alors méritait d'être poursuivi pour offenses à la majesté du trône, en vérité, ce ne serait pas nous. Oui, les ministres seuls sont légalement et réellement les auteurs du discours d'ouverture. De là cette œuvre rentre dans le domaine de la polémique, et, par conséquent, tout blâme, quelle qu'en soit la nature et la forme, est un blâme qui frappe le ministère et jamais au-delà. Ce serait absurdité que de vouloir entendre dans un autre sens la critique incriminée. Que chacun réponde de ses œuvres, comme cela doit être, et chaque phrase que l'on présente comme coupable deviendra innocente, louable ; car elle est inspirée par le sentiment du devoir. « Le discours de la couronne est nul et faux. » cela veut dire : messieurs Guizot et consorts ont mis du nul et du faux dans le discours de la couronne. « Il s'agira de voter une dot à la fille de Louis-Philippe. » Cela veut dire : le ministère demandera qu'on vote une dot à la fille de Louis-Philippe. — - Si j'avais 36 millions de revenu, je ne demanderais à personne à doter mes filles. » Cela signifie : le ministère a tort de demander au pays une dot pour la fille du roi, en présence d'une liste civille de 36 millions de revenu. « Si Dieu leur prête vie. » en d'autres termes : si le système actuel dure long-temps. — Que voulez-vous expliquer encore ? « Messieurs de la doctrine » veut dire messieurs les doctrinaires ; et cette phrase : « Il y a des gens qui meurent de froid et de faim », si vous ne l'entendez pas, je renonce à la mettre plus claire. Qu'on tourne mes phrases sur tous les sens, qu'on les torture de toutes les manières, on n'en pourra jamais exprimer autre chose que ceci : Le discours d'ouverture est mauvais; ce sont les ministres qui l'ont fait, et je blâme les ministres.
Je demande pardon à messieurs les jurés de m'appesantir autant que cela sur un point aussi clair. En logique on expose l’évidence, on ne la prouve pas ; mais quand l'accusation le nie, on me permettra d'insister pour la remettre dans son véritable jour.
Passons maintenant au second chef. L'accusation est-elle mieux fondée sur ce point ?
Messieurs, si la négation admettait du plus et du moins ; si dans le néant il existait des degrés, je dirais que la base de l'attaque est encore moins solide, encore plus fugitive que pour l'article précédent.
Le ministère public veut que j'aie excité à la haine et au mépris du gouvernement du roi.
Avant que de faire un seul pas dans la discussion, il est un point qu'il faut aborder de face, une question qu'il faut nettement résoudre, sans quoi toute argumentation sera obscure et inintelligible. Qu'entend-on par ces expressions, le gouvernement du roi ? Qu'est-ce que le gouvernement du roi ? Une expression aussi capitale, une dénomination qui sert à la base même de l'édifice constitutionnel, devrait, il semble, être nettement définie, clairement et précisément déterminée. Hélas ! messieurs les jurés, il n'en est rien ; ce mot gouvernement du roi, a été comme tant d'autres noms sacramentels, expliqué, commenté, déformé, torturé par l'un et par l’autre, selon un système de commande ou une passion du moment. On ne s'est plus entendu. La discorde s'est nourrie d'équivoques, d’ambiguïtés, d'explications erronées ou de mauvaise foi. De là, cette myriade de procès à la presse, pour une ligne, un mot, une ponctuation, une réticence, une faute de typographie ; procès parfois scandaleux, toujours affligeants ; procès où tout le monde perd ; le jury, un travail qui demanderait un meilleur emploi ; les parquets, leur temps et parfois de la considération ; la presse, les derniers lambeaux de sa liberté.
Qu'est-ce que c'est que le gouvernement du roi ? Question facile à résoudre, mais que l'on ne se fait pas de peur de la comprendre, que l'on ne comprend pas dans la crainte de ne plus exploiter l'équivoque que jésuitiquement l'on en fait sortir.
Un procureur général disait un jour : le gouvernement du roi, ce sont les ministres. Voilà qui est franc, net et hardi ; malheureusement pour la théorie elle n'est bonne qu'à Charenton. Otez-en la sottise il ne reste plus rien.
D'autres ont voulu faire du gouvernement du roi, un être collectif, espèce de polype immense, aux myriades de bras, qui enveloppe toute la France, et comprend toute personne qui exerce une fonction quelconque, depuis le roi lui-même, jusqu'au moindre garde champêtre, depuis le plus petit conseil de fabrique, jusqu'à la chambre des pairs et la cour de cassation. Luxorique corbeille aux vastes rebords, où l'on entasse à la fois les ministres et les gendarmes, les préfets et la police, les ambassadeurs et les espions ! Vous trouvez, cette théorie ridicule, eh bien !, je vous assure qu'elle existe, qu'on la soutient dans l'ombre, et qu'elle est en haute faveur là où elle devrait rencontrer une solennelle réprobation ; c'est encore là que nous retrouvons cette coterie dont j'ai déjà eu la douleur de vous entretenir, ces gens qui, timides et malfaisants comme des bêtes de nuit essaient de cacher sous un symbole de monarchie leur friperie doctrinaire. Ancrés à l'autorité, qu'ils veulent conserver à tout prix, parce qu’elle donne des honneurs et des masses d'or, ils voudraient s'inféoder à la royauté elle même, s'immobiliser au pouvoir, s'inoculer à la monarchie, s'identifier en un mot avec le gouvernement du roi. S'ils trouvaient en France une institution plus ferme, un symbole plus sacré, ils le choisiraient. Il y a vingt siècles ils se fussent posés comme des dieux, imposés comme des oracles.
En vain leur dira-t-on qu'au lieu de se purifier par cet alliage, aussi immoral qu'inconstitutionnel, ils souillent eux- mêmes la robe blanche de la royauté par leur contact impur ; qu'à force de se suspendre ainsi en longs groupes au char puissant de l'état, ils risquent de le précipiter dans l'abyme ; que, loin de partager les respects et l'inviolabilité attachés à la personne du roi, et aux corps constitutionnels qui font le gouvernement du roi, ils exposeraient eux-mêmes le trône à des traits qui ne sont destinés que pour eux. En vain l'évidence leur met elle devant les yeux qu'ils feraient haïr et mépriser le gouvernement du roi si un tel sentiment pouvait naître en France ! Leur égoïsme ne veut rien écouter, rien voir, rien entendre. Ils courront les risques les plus terribles, exposeront leur patrie aux plus épouvantables catastrophes, plutôt que de modérer leur ambition effrénée, leur cupidité insatiable. Que leur importe la ruine d'un pays ? ils en vivent. Le déshonneur devant l'étranger ? ils l'exploitent. La liberté mourante ? ils s'en font un marche-pied. La chute d'un trône ? ils savent se rattacher à un autre !
Ecoutez ces gens-là, le gouvernement du roi sera bientôt défini ; c'est eux, leurs amis, leurs adhérens, leur coterie, aux longues et sinueuses ramifications. Ils seront si vous voulez les croire aussi sacrés que le roi ; et, après s'être fait un rempart du trône ils s'en feraient un marche-pied.
Est-il besoin, messieurs les jurés, de discuter sérieusement de pareilles doctrines. Peut-être dites-vous, dans votre conscience, que le mépris doit en faire justice ; sans doute, cette réfutation est la plus raisonnable, mais elle ne m'est pas permise. Mis là, sur la sellette, il faut que je me défende pas à pas. Il faut que je prouve l'incontestable, que j'établisse les axiomes, que je rende claire l'évidence même, ou l'on dirait que je décline le combat.
Prouvons donc puisqu'on le veut, et, pour procéder avec une logique rigoureuse, une dialectique lucide et concluante, jetons des bases, et les suites se développeront aisément. Prenons d’abord, Messieurs, quelque idée bien vulgaire, bien connue de tous, connue comme la nuit et le jour.
Tout le monde sait ce que c'est que renverser un gouvernement, fonder un gouvernement. Juillet n'est pas loin, qui nous a montré cette idée matérialisée, et nous l'a fait toucher au doigt. L'Europe est là qui complète la série expérimentale, par vingt exemples semblables.
Après cette première idée, prenons-en une seconde. Tout le monde, sait ce que c'est que de déplacer, changer, destituer un fonctionnaire ; les exemples s'en voient tous les jours.
Maintenant, une première conséquence.
Quand on destitue un fonctionnaire, adjoint de campagne ou ministre, le gouvernement du roi est-il changé ? est-il affaibli ? ébranlé ? Rien de tout cela. Donc ce fonctionnaire n'était pas partie essentielle du gouvernement.
Si l'on voulait un jour, et la chose est possible, changer tous les préfets, tous les sous-préfets, les maires, les ministres et les procureurs du roi, le gouvernement serait-il changé ? Non : donc, les préfets, les sous-préfets, tous les fonctionnaires, en un mot, ne sont pas le gouvernement du roi. S'il existe une théorie claire et raisonnable, il me semble que c'est celle-là. Hors le cas des révolutions, et ce cas est anormal, exceptionnel ; car, sous quelque point de vue qu'on envisage une révolution, on conviendra que c'est une épreuve terrible pour un pays, et qu'il ne faut pas la comprendre dans un système gouvernemental : hors ce cas, dis-je, personne n'a le droit de renverser, de changer le gouvernement ; personne ! pas même le monarque. Donc, tout ce que le roi a le droit de changer, n'est pas partie intégrante du gouvernement ; car, dans le cas contraire, le souverain violerait les lois, tout en obéissant aux lois, briserait la constitution en restant dans les limites de la constitution : conséquence absurde et contradictoire , qui prouve évidemment la fausseté du point de départ. Ce serait une belle doctrine vraiment que celle qui revêtirait de l'inviolabilité royale le moindre estafier de la police, le fonctionnaire du rang la plus infime. Quel étrange gouvernement du roi ferait-on avec toutes ces vicissitudes. Ces changemens de politique, avec toutes ces infirmités humaines et sociales, morales et intellectuelles. Là, un dépositaire infidèle, un receveur banqueroutier un homme de poste faussaire, un administrateur vénal, un magistrat corrompu !... Et toute cette macédoine s'appellerait gouvernement du roi ! en vérité, je vous le répète, vous le feriez haïr, détester s'il était tel que vous le représentez.
C'est fâcheux vraiment, pour ceux qui reçoivent des traitemens, de ne pas les savoir inamovibles comme le trône, assurés comme la dotation de la couronne. Il serait doux et séduisant pour un jeune substitut qui fait ses premières armes de pouvoir dire : « et moi aussi, je suis du gouvernement du roi. » Oui, en effet, comme le portier fait partie de la famille, pour servir, en attendant qu'on en choisisse un autre.
Mais enfin, en quoi consiste le gouvernement du roi ? Le voici. Nous avons vu que tout ce qui est variable, transitoire, sujet à conteste, soumis à la discussion ne devait pas être l'œuvre du roi. De même, tout ce qui est invariable, inamovible, hors de conteste et de discussion, voilà le gouvernement du roi. Appliquons cette théorie, nous n'en sentirons que mieux la justesse. Les fonctionnaires en général, ce n'est pas là le gouvernement du roi ; car le gouvernement les change et pourtant il ne se tue pas lui-même. Une majorité de pairs, de députés, ce n'est pas le gouvernement ? car ces majorités sont variables ; un discours les forme, un trait de lumière les détruit. Une législature même n'est pas partie intégrante et indispensable du gouvernement du roi ; car une ordonnance peut la dissoudre et en convoquer une autre ; mais les chambres en elles-mêmes, les chambres, pouvoir de l'état, reconnu, fondé par la charte, voilà ce qui fait partie essentielle du gouvernement du roi. Gouvernement constitutionnel, gouvernement pondéré, représentatif ; gouvernement formé de trois portions intégrantes et indispensables, dont une ne peut être supprimée, que l'équilibre social ne se rompe, que la charte et les lois ne soient violées, qu'il n'y ait une révolution. Voilà, messieurs les jurés ce que j'entends par le gouvernement du roi, et non pas les agens de police, les espions et les geôliers ; gens qui ont leur utilité, peut-être , mais qu'on peut fort bien changer de place sans que la monarchie en soit ébranlée.
Veut-on considérer le gouvernement sous un autre point de vue : Eh bien ! le gouvernement du roi, c'est le gouvernement de la loi ; car le roi ne peut gouverner que par les lois. Or les lois sont l'œuvre des trois pouvoirs réunis. Nous voici, dès le premier pas , revenus à notre principe. C'est là le propre de la vérité. De quelque côté qu'on l'envisage, on se retrouve toujours au point de départ.
Messieurs, dans le moment actuel, le champ de la haute politique est divisé en deux camps principaux, dont l'un a pour devise : « le roi règne et ne gouverne pas. » l'autre : « le roi règne, gouverne et n'administre pas. » Comme ces deux opinions comptent des hommes probes et habiles, au moins quelques-uns , et que le différend continue pourtant et même s'envenime, j'ai soupçonné qu'il y avait là quelque malentendu et j'ai trouvé qu'en cette occurence, comme en beaucoup d'autres semblables , les uns et les autres ont raison , qu'ils sont d'accord au fond ; mais qu'ils ne s'entendent pas faute de s'expliquer. Chacun étant alors convaincu de la justice de sa cause, inspiré par sa conscience, persiste et lutte en adressant à ses adversaires des imputations d'ignorance et de mauvaise foi, qui lui sont renvoyées. La querelle s'échauffe, et, plus on dispute, moins on se comprend. C'est là l'origine de presque toutes les discordes qui tiraillent la société. Toute la difficulté gît dans les mots gouvernement, gouverner, que l'on ne définit pas, et que chacun traduit à sa manière. L'homme de l'opposition voyant l'homme du pouvoir abuser d'un mot sacramentel, attribuer au monarque ce que la loi n'attribue qu'aux ministres, faire intervenir partout, et parfois indécemment, le nom et la volonté du roi, là où l'on ne devrait voir que leurs œuvres, puis appeler tout cela gouverner : cet homme s'écrie : « Le roi ne gouverne pas. »
L'homme du pouvoir, craignant que l'on ne veuille ravir à la prérogative royale l'action constitutionnelle, la haute direction qu'elle doit avoir dans les affaires du pays, s'écrie : le roi gouverne et doit gouverner. Tous deux sont dans le vrai ; leurs pensées sont les mêmes ; mais les mots les séparent. De même, si, avant de me citer aux assises, M. le procureur général se fût donné la peine de se poser cette question : « Qu'entend-on, que doit-on entendre par ces mots : gouvernement du roi ? » à coup sûr il ne m'eût pas exposé aux frais d'un voyage et aux embarras d'un procès. Il aurait vu que je n'attaque pas le gouvernement, mais bien l'administration ; non le pouvoir monarchique, mais bien l'usage que font d'un pouvoir confié des agens amovibles et révocables ; non pas le roi des Français, mais le cabinet des doctrinaires, ainsi que les fonctionnaires qui suivent et parfois dépassent leurs déplorables maximes. Il aurait vu que, loin d'attaquer la constitution, je me plains que cette constitution est méconnue ; loin d'exciter au mépris du gouvernement du roi, c'est-à-dire du gouvernement des lois, je réclame avec force, énergie, avec rudesse même, si vous le voulez, contre ceux-là qui réellement méprisent les lois et, par conséquent, méprisent le gouvernement, dont elles sont la parole et la volonté.
Car c'est une étrange situation que la mienne ! Vous avez pu voir, messieurs les jurés, des hommes cités à cette barre pour avoir transgressé les lois , pour les avoir violées, pour avoir excité à les mépriser ; mais vous n'avez jamais vu, sans doute, un homme accusé pour avoir chaudement défendu la majesté des lois, pour s'être écrié avec une conviction profonde et une indignation impossible à contenir : « Nos adversaires sont les gardiens des lois et ne les exécutent pas ! ils les méprisent, les foulent aux pieds, s'en font une litière ; c'est le mot, une litière! » C'est ainsi qu'un droit sacré, le droit de rappeler les fonctionnaires à la pudeur, à la justice, à la moralité, à l'exécution de la loi, ce droit, je dis plus ce devoir ; car c'est un devoir, un devoir sacré pour tout publiciste honnête homme , pour tout citoyen consciencieux, de rappeler que la loi est un contrat qui lie également depuis le moindre jusqu'au plus puissant, tous les membres de la grande famille sociale ; ce devoir que chaque jour les procureurs du rai exercent sur leur banc, et les magistrats sur leurs siéger ; ce devoir, on m'en fait un crime ! On m'arrache à mon travail journalier, on me jette sur le banc des accusés parce que j'ai dit : nous gens de l'opposition, on sait bien nous forcer à l'exacte observance des lois ; et des fonctionnaires, qui les premiers devraient donner l'exemple, affichent au contraire le scandale de leur violation. Si j'avertissais de la présence d'un incendie, de l'existence d'un assassinat, on me punirait donc comme assassin et comme incendiaire ? Paul-Louis Courrier disait un jour : « Si je me plaignais d'avoir été volé, on m'arrêterait pour le voleur. » Eh bien ! messieurs, cette phrase spirituellement ironique a été mise en action. Aujourd'hui je me plains de la violation des lois et on me poursuit comme violateur des lois. Où allons-nous donc et que deviendrons-nous ? Jusqu'où donc nous entraînera ce système qui frappe, avec la même énergie, le bien et le mal, l'égoïsme et le dévouement, le crime et la vertu ? Ah ! je le répète, oui ; c'est là une étrange situation ! Et, grâce à l'inconcevable poursuite qui s'acharne contre moi, cette procédure, quelle qu'en soit l'issue, restera comme un monument caractéristique de ces temps malheureux, de cette sinistre époque où l'on nous arrache brin à brin, feuille à feuille, cette belle couronne de liberté que la France avait conquise au prix de sou sang !
Mais peut-être oubliai-je quelque délit, quelque crime, un attentat, que sais-je ? obscurément caché sous une petite phrase, dans le recoin d'une période, sous un adjectif mal sonnant, dans un verbe à signification ambiguë. Lisons, examinons jusqu'au moindre mot.
AU COURRIER FRANÇAIS.
PROCÈS A LA PRESSE.
« Le Courrier est saisi, le Siècle est saisi, le Temps est saisi, il y en a, je pense, un quatrième. La plupart de ces saisies ont pour prétexte que la presse a fait remonter jusqu'au roi la responsabilité des actes du gouvernement. Le Courrier s'étonne que l'on chicane l'opposition pour dire ce que répètent à satiété les ministres eux-mêmes, et la presse ministérielle en masse. Ce qui nous étonne, nous, c'est la surprise du Courrier. Comment les hommes de talent qui rédigent cette feuille, peuvent-ils aussi mal comprendre la situation actuelle ? Les lois d'après nos maîtres ne sont plus des contrats, ce sont des instrumens, des outils, un cadre dans lequel s'arrangent les passions méchantes des gouvernans qui nous exploitent. Ils nous poursuivent pour la moindre atteinte aux lois, atteinte souvent imaginaire, et eux s'en font une litière, c'est le mot, UNE LITIÈRE ! Depuis la charte jusqu'aux lois de septembre, il n'est pas une disposition légale que le moindre des estafiers du pouvoir ne se fasse un jeu de fouler aux pieds, à la moindre occasion. Quant à nous, on nous poursuit avec rage pour l'ombre d'un délit, on nous poursuit même pour être fidèles aux lois ; c'est incroyable, mais c'est vrai ! Oui, le ministre Guizot a fait remonter jusqu'au roi » la responsabilité des actes gouvernementaux. Nous l'avons entendu (par les fenêtres, croyez-le) professer cette étrange doctrine. Le lendemain, la feuille policière qu'il a fondée chez nous le redisait à qui voulait la lire, et Guizot n'est pas poursuivi. Pourquoi cela ? voici le mot de l'énigme.
Il est permis de s'affranchir de toute loi pourvu qu'on flatte, qu'on adule, qu'on se jette à plat ventre devant EUX ! Courtisez, adorez, comparez au soleil, peignez des auréoles, tout sera bien. Retrouvez votre dignité d'hommes, marchez sur les pieds et non sur les genoux ; oh ! alors, guerre sans relâche, poursuites sans raison, condamnations sans pitié ! Le maire de Thorigny prête une salle ; destitué ! Cet Odilon-Barrot qui fait de l'indépendance ! Le maire de Lisieux prête aussi une salle, mais quelle différence ! c'était pour que Guizot y prêchât ses venales flagorneries. Le maire de Lisieux se carre toujours avec son écharpe. Les conseils municipaux, la garde nationale faisaient des adresses politiques, mais flatteuses : un sourire et un merci ! Des conseils, des compagnies font ils entendre un seul avis ; brisés ! dissous ! destitués ! foudroyés s'il était possible ! Les articles les plus saints de la constitution sont suspects, s'ils ne flattent pas le pouvoir. Ce n'est qu'en tremblant qu'on ose dire que le peuple est souverain, que la pensée doit être libre ; mais dites hardiment, comme la Presse, qu'il n'y a rien au-dessus du roi (pas même la France qui lui a donné la couronne), et personne ne vous poursuivra. La loi est de luxe maintenant. Flattez, faites-vous bien vil, bien humble, comme Turc et Azor, vous aurez la caresse et l'os à ronger. Levez la tête et souvenez-vous que vous êtes hommes, on vous tiendra le poignard sous la gorge. »
Je regarde, je cherche, je ne trouve pas ! Partout, à toute ligne, une attaque vigoureuse, contre le malheureux système qui pèse sur nous ; un reproche de ce qu'il regarde les lois comme des instrumens pour frapper ceux qui lui déplaisent, et non un contrat sacré devant lequel lui aussi, lui avant tous devrait baisser la tête ; un reproche à ces gens qui réclament, sous le nom du roi, dont ils se font une égide, et qu'ils déshonoreraient, s'il pouvait l'être, qui réclament, qui exigent des flatteries, des adulations, des bassesses, et qui s'indignent avec arrogance, de ce qu'on ose devant eux lever la tête, et reprendre sa dignité d'hommes. Il n'est pas étonnant, en effet, que des gens qui se font de la peur un moyen gouvernemental inscrivent la honte au nombre des qualités indispensables aux citoyens français. Libre à eux d'être conséquents dans leur voie fatale, mais libre à moi de jeter un blâme énergique sur une aussi déplorable tendance. Eh ! bien, je l'ai fait, je l’avoue, j'ai dû le faire, et ma conscience me dit qu'à cette heure je le ferais encore. Mais le roi, le gouvernement du roi, loin d'en parler avec haine et avec mépris, je n'y ai pas songé ; si non, pour rappeler à nos fonctionnaires qu'ils ne font pas leur devoir. Un tel acte est si peu coupable que le gouvernement lui-même le fait en toute occasion ; car, souvent, jusqu'ici, on a destitué des fonctionnaires, et, s'il plaît au ciel, on en destituera encore.
« Mais, dit-on, le sens est caché, et pourtant l'on distingue vos intentions. Sous un voile diaphane, on voit que c'est du roi lui- même que vous voulez parler, ou du moins vous le comprenez avec les ministres. »
Messieurs, à celui qui vous accuse de mauvaise foi, si l'on est trop poli pour retorquer ad hominem, on affirme sa bonne foi et cela suffit. La négation vaut l'affirmation. Vous dites : oui, moi je dis : non, et la chose reste dans le premier état. Mais ce procédé, quoique logique et rigoureusement juste, ne convient pas à ma franchise. J'ai des preuves morales de ma bonne foi, et je vais en donner.
Depuis deux ans et demi je rédige le Patriote, et jamais un mot, une phrase contre le roi ou le gouvernement ne m'est échappée. Vous en avez pour garant le silence de messieurs du parquet, et Dieu sait qu'en fait de délits de presse ils voient clair. Il faut donc reconnaître que ma manière de discuter est compatible avec le gouvernement constitutionnel, ou me supposer une prudence, un calcul incapable de faillir, une finesse vraiment sur humaine. Mais alors il y aurait contradiction manifeste. Car, si j'avais cette prudence si bien calculée, prudence qui serait sortie victorieuse de l'épreuve pendant deux ans et demi, comment m'aurait-elle abandonnée juste au moment où j'en avais besoin, à la première signature que j'engageais, la première fois que j'encourais la responsabilité légale de mes œuvres ? Je serais bien mal avisé, vraiment, d'avoir tant d'habileté au service des autres, et de n'en pas trouver pour moi-même. Je pourrais citer ici textuellement au moins cinquante articles que j'ai écrits, où le roi, son autorité constitutionnelle, le gouvernement monarchique, sont nettement formellement distingués du système ministériel, système dont la grammaire veut que je varie les noms, pour être moins monotone, mais que l'on reconnaît toujours à des caractères indélébiles. Mais je craindrais de fatiguer par cette discussion déjà longue ; je me bornerai à un seul article, bien court, bien clair, qui justement est là , dans la feuille incriminée , au revers de la page. Cet article, je l'ai écrit, si j'ai bonne mémoire, une heure après l'adresse au Courrier, et sans l'inspiration de la même pensée.
(Ici le prévenu lit un article où l'on reproche aux ministres de se cacher lâchement derrière le roi.)
Je vous le demande, Messieurs, je le demande à quiconque sent battre sous sa poitrine un cœur d'honnête homme, cet article décèle-t-il le désir d'offenser le roi, d'exciter à la haine et au mépris de son gouvernement ? Cet article confond il le roi avec le ministère ? N'y trouve-t-on pas plutôt le publiciste franc et bon citoyen, qui sonde toutes les plaies du pays, et à toutes propose un remède, sans phrases entortillées, sans ambages, mais clairement, comme il convient à un homme de cœur, et en allant droit au but.
Dans le premier article qu'on incrimine, je vois les intérêts du pays menacés, et je dis : « Respect aux intérêts du pays » ! Dans un autre, en face, des lois foulées aux pieds, je dis : « Respect aux lois » ! Dans le troisième, c'est le roi que menace l'assassinat, et je dis : « Prenez des mesures pour protéger la personne du roi. »
L'accusation vous a dit que j'étais coupable pour cela ; je me trouverais vraiment coupable, au contraire, si en présence des malheurs qui pèsent sur mon pays je n'élevais pas une voix courageuse pour essayer de les conjurer, et j'ai trop de confiance dans la probité indépendante du jury pour ne pas être sûr qu'il partagera mon opinion.
Messieurs les jurés, quelqu'éclairée que soit la question, au point où nous en sommes, je ne puis terminer sans mettre sous vos yeux un dernier argument, car il est décisif.
Voulez-vous savoir si un écrit est coupable ou innocent ? Voici un criterium, une pierre de touche, un moyen d'épreuve qui ne vous trompera jamais.
Admettez pour un moment ce que dit l’auteur, supposez que toutes ses assertions sont réalisées, que ses exhortations sont écoutées de tout le monde, que tout ce qu'il veut est fait, et voyez ce qui en résulte.
S'il en résulte une commotion, un désordre, une révolution, l'écrit est coupable, condamnez.
Si, au contraire, il en résulte un mouvement progressif, constitutionnel, permis et prévu par les lois, certainement l'écrit est innocent, renvoyez absous.
Appliquons ce principe de jugement aux passages accusés :
Dans les quelques lignes où l'on prétend que j'ai offensé le roi, je me plains qu'on veuille prendre un million sur le budget pour la dot de la reine des Belges. Eh, bien ! qu'on ne le donne pas. C'est un million de plus qui restera en France et dans la poche des contribuables, au lieu d'aller payer les aides-de camp du roi Léopold ; ce ne sera pas un si grand malheur. Il se peut bien que la chambre pense ainsi, et qu'elle rejette la demande ; et, puisqu'elle a bien le droit de le faire, moi, français et contribuable, j'ai bien le droit de le dire.
J'ai dit que la doctrine épuise la France comme une vache à lait. Eh, bien ! la doctrine changera, ou l'on changera la doctrine, et en vérité il n'en résultera pas une révolution. Le roi peut bien demain renvoyer les sept ministres actuels, que le pays ne s'en insurgera pas. J'ai dit qu'en France il y a des malheureux qui meurent de faim.
Je voudrais du fond de mon cœur avoir dit une fausseté, dussé-je, à ce prix, être déclaré coupable ; mais, malheureusement, il n'en est rien. Je conçois que ces tristes tableaux déplaisent aux hommes qui prennent sur l'impôt d'énormes sommes pour payer leurs soirées et bâtir de magnifiques hôtels ; mais qu'y faire ? Organiser le travail, soulager l'indigence, employer mieux le milliard du budget. Croyez-vous que tout cela amène la révolte et l'anarchie ? Je ne le pense pas ni vous non plus.
Passons au grand article.
Je me plains que les lois ne pèsent pas également sur tous. Eh, bien ! on y soumettra tout le monde ; les fonctionnaires les premiers donneront l'exemple de l'obéissance et de la fidélité. Les choses en iront elles plus mal ? Je me plains qu'on encourage la flatterie, qu'on l'exige même ; eh, bien ! on la chassera, on la détruira.
Je me plains que les ministres les premiers, et notamment M. Guizot, font remonter jusqu'au roi la responsabilité de leurs actes. Eh, bien ! ils ne le feront plus, ils rentreront dans les voies constitutionnelles.
J'ai dit qu'on persécute l'indépendance ; on la respectera.
Qu'on nous enlève notre liberté ; on nous la rendra.
Qu'on s'en prend à notre dignité d'hommes ; on la laissera à ceux qui la conservent, et l'on essaiera de la rendre aux malheureux qui l'ont perdue !
Y aurait il un grand malheur à tout cela ? Il serait beau, il serait juste et moral de le faire et parce que je le demande on me poursuit ! Je veux que l'argent de la France reste à la France, on dit que j'offense le roi. Je réclame l'exécution franche des lois, on dit que j'attaque le gouvernement ! C'est à n'y rien comprendre. Ainsi, pour être innocent, je devrais donc dire le contraire ? Proposer la dilapidation des produits de l’impôt, et encourager les infractions des lois ? Je vous le répète, en vérité et en conscience, l'accusation est inconcevable, elle n'a pas de sens.
Laissant de côté, le roi dont je ne m'occupe pas, et le gouvernement que j'attaque beaucoup moins que ses prétendus amis, je concevrais de la part du parquet, une sommation en ces termes :
« Vous accusez des hommes du pouvoir de transgresser les lois ; cette imputation est grave, il faut la justifier, ou l'on vous jettera à la face le nom de calomniateur ! »
A la bonne heure ! voilà un appel basé sur la raison et la vérité. Eh, bien ! j'y répondrais, je soutiendrais mon dire, je le prouverais pièces en main. Justice serait faite et tout serait dit.
Car, sachez le bien, messieurs les jurés, je ne viens pas ici, invoquant l'indulgence, demander grâce pour la vivacité d'expressions mal pesées, et m'excuser sur la chaleur d'un travail précipité. C'est le moyen d'un homme peureux, qui se sent coupable, et qui voudrait arracher à la compassion un verdict d'acquittement. Je ne demande que justice, sévère justice. Tout ce que j'ai dit, j'ai cru devoir le dire ; je l'ai fait, dicté par ma conscience, le sentiment de mon devoir, et, quoi qu'il arrive, je suis prêt à le soutenir. S'il en était autrement, je mériterais d'être condamné, non pour offense envers le roi ou attaque envers le gouvernement, mais bien pour diffamation envers des fonctionnaires.
Ici, Messieurs, j'aurais trop beau jeu pour faire du scandale, si je le voulais. Je pourrais vous apporter une masse de faits où partout vous verriez la loi torturée par des fonctionnaires, foulée aux pieds par ceux là qui devraient s'en montrer les défenseurs. A côté des petites persécutions locales, des injustices à domicile, des partialités pour la coterie, je pourrais vous montrer de ces hommes qui font curée de la loi et se gobergent dans leur impunité, comme des valets en goguette, à l'absence du maître. Je pourrais vous citer de ces crimes qui clouent au pôteau et entraînent pour dix ans dans les bagnes!... Je ne le ferai pas. Je ne citerai qu'un fait, un seul ; parce qu'il me suffit, et qu'il est connu de tous.
En parlant du grand scandale de Strasbourg, je veux dire la violation ministérielle de la charte, un ministre est venu à la tribune dire :
« Oui, nous avons violé la loi, nous le savons bien, et nous courons au-devant de la responsabilité !... »
Il me semble qu'en présence d'un si affligeant scandale, un écrivain peut bien dire aux gens du pouvoir : « Vous vous faites des lois une litière, c'est le mot, une litière ! » Eh, bien ! ces hommes on les choie, on les protège, on les récompense même, et moi qui signale la plaie à guérir, on me traîne au banc des voleurs et des assassins, on demande que vous me déclariez coupable, qu'un jugement me condamne ! cinq ans de prison et dix mille francs d’amende !!! C'est-à-dire, ma ruine complète, la perte de mon avenir, et peut-être une mort de langueur sur la paille humide des prisons ! Et pourquoi ? Parce qu'au nom d'un pays où des malheureux meurent de misère, je me suis opposé à un projet de loi qui flatte le penchant courtisan de la coterie doctrinaire ; parce que je vois des abus et que j'ai le courage de les dire en face ; parce que depuis long-temps on me guette au passage, et qu'on m'a saisi, au hasard, à la première signature ; parce qu'à tort ou à raison, on me regarde comme le seul qui puisse écrire un journal indépendant à Lisieux, et que c'est un parti pris de tuer tous les journaux indépendants ; parce que je défends la liberté, et qu'on veut nous arracher les derniers lambeaux de cette liberté sans que personne la défende ; parce qu'enfin , et cela résume tout , je suis l'ennemi de la guizolâtrie locale, et que la guizolâtrie locale, qui pardonnera volontiers les offenses au roi et les attaques au gouvernement, ne pardonnera jamais les offenses à la doctrine, et l'expression du mépris pour ses sectaires et ses adhérens. On dit que j'ai offensé la personne du roi, que j'ai excité à la haine et au mépris du gouvernement du roi, cela n'est pas vrai. Cette accusation est fausse, si évidemment fausse qu'il est impossible de s'y méprendre. Ce n'est là qu'un prétexte, qu'une formule extérieure et banale ; le sens est tout autre et je vais vous le traduire.
« Le rédacteur de l'Ami des Patriotes du Calvados et de l'Eure, a commis le délit d'offenses envers la personne de sa majesté Guizot 1er, roi de la doctrine, et d'excitation à la haine et au mépris d'une petite coterie de jésuites tricolores, qui voudraient se faire appeler le gouvernement du roi. »
Voilà mon véritable crime, et comme je ne suis guères repentant, on doit me trouver très-coupable.
Vous, messieurs les jurés, placés au point de vue plus élevé de l'intérêt du pays, qu'ici vous représentez, et devant le gouvernement royal que vous savez comprendre, vous verrez que loin de les attaquer je me trouve en être le véritable défenseur ; et, comme il n'y a que de l'honneur à prendre la défense du pays et des lois, vous direz :
« Non l'accusé n'est pas coupable. »
*
* *
Cette défense fut écoutée avec le plus grand silence, à la grande surprise de quelques amis pessimistes, qui offraient à tout venant de parier que je serais rappelé à l'ordre, au moins deux fois ; s'imaginant sans doute que je me défendrais à la manière de Vignerte et de Considère.
— « Défenseur, dit M. le président à Me Bayeux, qui m'assistait, n'avez-vous rien à ajouter à la défense du prévenu. »
— « Je voudrais savoir si le ministère public a l'intention de répliquer. » (M. l'avocat-général fait un signe négatif.)
« Dans ce cas, continue Me Bayeux, je n'ai que deux mots à dire. Je ne vous rappellerai pas cette phrase : « Plus de procès à la presse ! » Comme on disait autrefois : « Plus de hallebardes ! » On sait ce que tout cela veut dire. Je ferai seulement remarquer une petite inexactitude de l'accusation. M. l'avocat-général dit à MM. les jurés que si dans le premier article ils ne voient pas d'offense envers le roi, au moins y trouveront-ils le délit d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement. Or ce nouveau délit n'est pas dans la citation, et il n'est pas permis de dénaturer ainsi l'accusation. — « Cela peut-être, répond M. l'avocat-général, je n'ai pas lu la citation. Voyons. »
On passe le papier à M. l'avocat-général, qui ne l'avait pas lu. Il le lit et reconnaît la justesse de l'observation. On voit, par parenthèse, comment mes adversaires faisaient la besogne en conscience.
Pour tout résumé, M. le président, lut les articles incriminés. C'était la troisième fois que l'auditoire les entendait ; jamais l'Ami des Patriotes n'avait eu une aussi belle publicité. Le débit du magistrat fut d'abord sec et froid ; mais peu à peu la forme énergique de la phrase l’entraîna, peut-être à son insu, sa voix prît de l'élévation et de la chaleur, un accent entraînant et pénétré, au point que toute la fin du grand article au Courrier fut prononcée sur le ton d'une chaude et éloquente déclamation. J'en étais tout stupéfait ; je reconnaissais à peine mon œuvre ; je ne croyais pas avoir fait un aussi beau morceau. M. Feron Delongcamps lit fort bien, et si, comme je l’espère, je relève une feuille politique, je veux lui faire hommage d'un abonnement, pour le remercier.
Après la lecture, M. le président posa au jury ces deux questions :
1° Le prévenu a-t-il offensé la personne du roi ?
2° A-t-il excité à la haine et au mépris du gouvernement du roi ?
Et le jury entra dans la salle de ses délibérations.
Pendant cette délibération, qui dura vingt minutes à peu près, messieurs de la cour et du parquet paraissaient très-occupés à lire. Je pensai que c'étaient quelques lois applicables dans l'espèce. Mais une personne placée auprès de moi, et dont la vue est plus longue que la mienne, reconnut très-distinctement deux brochures de ma façon, une comédie en vers et un vaudeville, Ma Belle-Mère, et Le Forçat par Circonstance. Je ne m'attendais guères à retrouver là mes œuvres, qui toutefois paraissaient égayer beaucoup messieurs les magistrats.
Le jury rentra, et le bruissement de l'assemblée s'éteignit par dégrés. Alors M. le président après avoir sévèrement défendu tout signe d'improbation ou d'approbation, demande la déclaration du jury. Elle était négative sur les deux questions, et la cour prononça l'acquittement.
Ce résultat, quoique prévu, causa une joie vive à la masse de l'auditoire, qui s'y intéressait. La nouvelle s'en répandit dans Caen avec une promptitude électrique ; à la soirée tout le monde en parlait. Personne ne parut ni fâché ni désappointé ; pas même l'avocat-général, qui, j'ai des raisons pour le dire, luttait par devoir, malgré lui, et sans conviction. Je l'aurais bien pris pour un de mes juges.
A Lisieux, à mon retour, j'ai reçu des marques nombreuses et touchantes de sympathie. Les félicitations, que je crois toutes sincères, sont arrivées comme un flot. Mais là aussi j'ai retrouvé quelques figures allongées, quelques mines piteuses. Honnêtes guizotiers, qui ont eu plus d'une indigestion en voyant que je n'étais pas en prison. Que le ciel et l'opinion leur pardonne! Je ne parle pas de leur conscience ; ils l'ont ôtée pour mettre à la place un sac d'écus !
Ils ont trouvé le moyen d'exercer une petite vengeance à leur manière. Après avoir annoncé mon procès dans le Normand, ils n'ont pas fait connaître mon acquittement. Qui sait ? deux ou trois de leurs lecteurs croiront peut-être que je suis pendu.
Ainsi finit cette histoire serio-comique ; petit procès de taquinerie, que la malveillance avait enflé outre mesure, pour lequel on avait bourré de réquisitoires furibonds les colonnes du Mémorial, et mis sous presse les lazzis dénonciateurs de son confrère l'aboyeur lexovien ; ce procès qui devait me frapper comme la foudre, et qui a manqué comme un mauvais pétard qui crève dans la main. Cette affaire n'a pas été pourtant sans fruit pour la cause ; le verdict des jurés ajoûté à tant d'autres, prononcés dans le même sens ; le nombre, j'ose dire immense, de personnes qui ont pris intérêt à cette cause ; la sympathie que la jeunesse, surtout la jeunesse éclairée et studieuse, a montrée pour l'écrivain, ami du progrès et de la liberté ; tout cela prouve qu'il y a de la sève au sein des masses, et qu'on doit avoir bonne espérance pour l'avenir. Nos adversaires voyant le calme avec lequel on souffre toutes leurs fredaines, ont cru que le patriotisme était mort ; c'est une erreur ! il n'est qu'endormi pour un temps, il se réveillera. Espérance et courage !
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par cgs611 le 27 Mai 2021 à 12:16
LA DIALECTOLOGIE NORMANDE
Par GUERLIN DE GUER, Charles (1871-19..) : La Dialectologie normande : Organisation et méthode (1899)
Saisie du texte :
Messieurs,
Qu'est-ce, au vrai, qu'un patois ; et qu'est-ce que le patois normand ?
Quelles sont, en matière de patois, les recherches qui peuvent être le plus légitimement conseillées et favorisées ; à quelles règles de méthode convient-il de s'astreindre au cours de ces recherches, ainsi que dans les travaux ultérieurs dont elles seront l'occasion et l'objet ?
Tels sont les trois points que je me propose de développer très brièvement devant vous.
Nul de vous n'ignore, Messieurs, que les armées romaines ont importé sur notre sol gaulois, entre autres produits latins, leur propre langue, — langue de soldats et langue de marchands à la suite — fort éloignée, sans doute, de celle qu'écrivait, de celle même que parlait un César ou un Cicéron, langue vulgaire, en un mot, qui demeurait, toutefois, bien latine dans son esprit et dans sa teneur générale. Il est intéressant d'examiner quel fut le sort de cet idiome à compter du jour où, violemment arraché à son domaine de développement naturel, il se sentit en contact avec maints parlers divers, d'une origine essentiellement étrangère.
Qu'advint-il de cette végétation exotique transplantée dans une terre qui n'avait pas été préparée à la recevoir ? Il faut bien admettre que cette terre contenait toutes les propriétés utiles à la vie de l'étrangère, puisque celle-ci ne tarda pas non seulement à s'acclimater, mais encore à pousser en tous sens de robustes rejetons.
Toute langue étant un organisme sans cesse en évolution, sans cesse en travail, il va sans dire que le latin vulgaire, introduit en Gaule, ne devait pas, ne pouvait pas demeurer stationnaire. Il se modifia par voie de déformations successives et insensibles, tant et si bien qu'au bout de quelques siècles, il donnait déjà comme la sensation d'une langue nouvelle.
A cette langue, d'ailleurs très éloignée de la perfection, il manquait une qualité maîtresse : l'unité. Rayonnant de toutes parts, sur toute l'étendue du pays, exerçant l'influence de ses flexions et de son esprit jusque dans les villages les plus retirés, le latin vulgaire avait donné naissance à autant de parlers qu'il rencontrait de centres favorables à son développement, et provoqué autant de combinaisons linguistiques, autant de croisements différents. Les deux éléments composants — l'élément latin et l'élément indigène — étant, eux-mêmes, respectivement très variables, chacun des composés devait conserver sa marque propre d'origine, et il la conserva longtemps.
Toutefois, la nécessité d'élargir le cercle des rapports sociaux força les représentants d'un certain nombre de groupements d'adopter une langue compréhensible à chacun d'entre eux. C'est ainsi que, non sans quelque peine au début, tous les habitants d'une province se comprirent entre eux, tout en restant fidèles, chacun chez soi, aux particularités caractéristiques de leurs parlera locaux. A la période première de confusion succéda donc une période d'unification partielle.
Cette unification partielle s'étendit à la langue écrite après s'être exercée sur la langue orale ; chaque province eut sa langue écrite, autrement dit chaque province eut son dialecte : ce furent les dialectes écrits en Picardie, en Bourgogne, en Normandie ou dialectes picard, bourguignon, normand. Je n'ai pas à faire, ici, l'histoire de ces dialectes ; je rappelle seulement combien brillante fut celle de notre dialecte normand.
Cependant, la langue écrite dans la province de l'Ile-de-France parut, d'assez bonne heure, appelée à une destinée que rien dans sa constitution propre n'avait laissé prévoir.
A la faveur d'un concours de circonstances politiques sur lesquelles je n'ai pas à insister, le dialecte de l'Ile de France eut tôt fait d'éclipser ses voisins. La substitution de ce dialecte à tous les autres fut tellement prompte et complète qu'au XIVe siècle il n'y eut plus ni dialecte champenois, ni dialecte picard, ni dialecte normand, mais un seul dialecte, le dialecte français, et l'on peut dire qu'une seule langue, la langue française.
Dans la grande débâcle des dialectes, les parlers étaient restés indemnes, toujours vivants dans leur infinie diversité. Il n'y eut plus de dialecte champenois, picard, normand ; il y eut toujours un parler champenois, picard, normand ; et si des années ont suffi au dialecte de l'Ile de France pour imposer sa suprématie aux autres langues écrites de ce côté-ci de la Loire, des siècles ne suffirent pas au parler de l'Ile de France pour triompher de ses voisins, les parlers locaux.
Ces parlers, malgré le travail incessant, malgré l'action lente et destructive de l'influence française, ont trouvé, dans leur constitution propre, une force suffisante pour lutter avantageusement ; ils présentent, encore aujourd'hui, tout un ensemble de phénomènes qui les signalent et les recommandent à l'attention et aux recherches des linguistes. Ils valent d'être étudiés comme autant de survivants de langues autrefois autonomes ; ils sont les héritiers directs des langues parlées il y a huit siècles, et des langues écrites sur l'étendue de chacune de nos anciennes provinces ; ils sont, par suite, les frères, disons plus exactement les frères cadets de notre langue française moderne.
Qu'est-ce à dire, Messieurs ? Les patois ne sont donc pas ce qu'en a fait longtemps l'opinion commune.
« Le peuple de l'arrondissement, dit, en 1812, le sous-préfet de Domfront, ne parle point un dialecte particulier, ni un patois distinct. Seulement il prononce mal les mots, et les dénature en partie ; il dit, par exemple, coutia, tonia, tru, rote... Comme le défaut de prononciation ne peut servir à expliquer d'anciens usages, ... à donner la clef des chartes et autres documents historiques, j'ai pensé, ajoute l'honorable fonctionnaire, qu'il était inutile de vous faire part de la mauvaise prononciation du peuple ».
Qu'il soit possible, Messieurs, de relever à peu près autant d'erreurs que de mots dans une appréciation linguistique et surtout dialectologique datant de près de 90 ans, voilà qui ne saurait nous étonner ; mais prenez garde qu'une fraction importante du grand public en est restée au jugement de M. le Sous-Préfet de Domfront. Pour ma part, je ne compte plus les occasions où il m'a été donné d'entendre raisonner de pareille sorte sur la valeur et sur la nature des patois. Les mots français sortent dénaturés, dit-on, de la bouche du peuple. Si le peuple dit coutia pour « couteaux », tonia pour « tonneaux », tru pour « truie », rote pour « route », autant de défauts de prononciation, autant d'exemples d'un français écorché dont les paysans ont le monopole.
La théorie compte encore trop d'adeptes convaincus pour qu'il soit superflu de la réfuter. Après ce qui a été dit, d'ailleurs, la réfutation ne sera ni longue, ni malaisée.
Puisqu'il est reconnu que les patois sont frères et non descendants du français et que l'évolution des sons patois s'est opérée parallèlement à celle des sons français, il est difficile de voir dans les uns autant de déformations des autres. Un patois qui serait sorti de toutes pièces du français moderne impliquerait déformation de ce français, et, semblablement, il est légitime de reconnaître, dans les langues romanes primitives, autant de déformations différentes du latin, — celui-ci étant la souche commune de toutes celles-là — de reconnaître, au même titre, dans les patois de France, des déformations particulières de ce même latin, mais non du français. Qu'on n'aille pas dire qu'aujourd'hui du moins, quand tel mot moderne récemment créé pénètre dans le lexique du paysan, il y subit une déformation. Il se modifie, sans doute, mais en se conformant aux lois phonétiques du patois où il pénètre, et dans cette mesure seulement.
Et, bref, le patois normand n'est pas du français déformé, mais bien de l'ancien normand modifié. Là où le français dit « route », le normand moderne dit rote, et le normand du XIIe siècle le disait et l'écrivait déjà ; là où le français dit « truie », le normand moderne dit tru, c'est une forme dialectale dont les analogues se relèvent dans les mss. anglo-normands. Comment, à ce compte, soutiendra-t-on valablement que la connaissance de ces particularités n'est pas capable de nous donner la clef des chartes ? Les érudits en jugent autrement aujourd'hui, et ils demandent précisément au patois l'explication de formes relevées dans ces chartes, et que le français est parfois impuissant à éclaircir.
L'étude du patois en tant qu'auxiliaire de la philologie romane, l'étude aussi du patois considéré en lui-même a donné naissance à une science connue sous le nom de Dialectologie.
Quelles sont les recherches de dialectologie normande qui peuvent être les plus légitimement recommandées ; quelle méthode observer dans ces recherches ? Tels sont les deux points qui me restent à examiner.
Il faut partir du fait suivant qui n'échappe à aucun de vous, Messieurs, à savoir que les patois présentent, sur l'étendue d'une seule province, des différences sensibles, puisqu'ils varient de canton à canton, souvent même, par quelque côté, de village à village.
De quelle utilité vraie sont donc ces lourds et imposants in-folios où maint esprit chercheur a prétendu nous présenter l'image du patois d'une province tout entière, d'un département, voire d'une région moins étendue encore ?
De tels répertoires supposent, sans doute, une somme de recherches souvent considérable ; ils méritent d'être feuilletés pour le trésor des mots qui y sont renfermés. Ils ne sauraient, toutefois, fournir de matériaux propres à l'étude de l'évolution phonétique des patois ; à l'étude de la distribution topographique de ce patois ; à l'étude de l'influence française.
Tout dictionnaire du patois d'une province, d'un département, d'un canton, a ce défaut capital de nous renseigner non pas sur les parlers de toute cette province, ou de tout ce département, mais sur le parler d'un village-type arbitrairement érigé en représentant de tout un domaine linguistique. Autant le donner pour ce qu'il est réellement, je veux dire pour le glossaire d'un village. Nous n'aurons pas ainsi l'illusion d'une tâche achevée alors qu'elle est seulement à l'état d'ébauche, et chacun y trouvera son compte.
« Il faudrait, a dit M. Gaston Paris, que chaque commune, d'un côté, chaque son, chaque forme, de l'autre, eût sa monographie, purement descriptive, faite de première main et tracée avec toute la rigueur d'observation qu'exigent les sciences naturelles ».
Voilà donc une première catégorie de recherches bien capable de tenter le zèle et l'esprit d'observation des amateurs et des lettrés, de ceux, surtout, que leurs fonctions ou leurs goûts ont retenus longtemps à la campagne et qui se sont rendu familiers les sons patois, pour en avoir eu l'oreille constamment frappée. Que si la confection d'un glossaire leur parait une tâche ou trop aride ou de trop longue haleine, ils se contenteront de notes d'une courte étendue qui pourra porter sur de multiples sujets.
Partant toujours du parler d'un seul village ou, plus exactement, d'un groupement social bien limité, ils y étudieront les particularités de la grammaire ou de la syntaxe patoise, ils en relèveront les particularités phonétiques les plus remarquables, les plus caractéristiques.
C'est à l'examen phonétique, c'est-à-dire à l'examen des sons dans leur évolution tantôt régulière, tantôt tourmentée, et jusque dans les nuances les plus insensibles que nous sommes ramenés de toutes parts. Tout travail approfondi portant sur ce sujet suppose au moins quelque connaissance générale de l'histoire des sons dans leur passage du latin au français moderne et, parallèlement, au patois de nos jours.
Afin de faire profiter le plus grand nombre du résultat de ces recherches, afin d'introduire l'unité nécessaire dans ces études et de préparer les synthèses ultérieures, il conviendra d'adopter un système de transcription de sons qui soit moins défectueux, moins décevant, qui présente une image plus sincère des sons que ne le ferait notre orthographe française moderne.
La transcription des sons patois a toujours été la pierre d'achoppement des dialectologues. Il n'est pas sans intérêt de remarquer que, de tous les travaux sérieux entrepris en matière de patois, pas un seul n'est antérieur à l'époque, — rapprochée de nous — où les patoisants se sont astreints à une notation méthodique et rationnelle des sons.
L'alphabet le plus répandu — il me parait d'ailleurs être d'un maniement aisé et n'exiger qu'un court apprentissage — fut adopté et éprouvé par les directeurs et rédacteurs de la Revue des Patois gallo-romans pendant ses sept années d'existence. Il vous sera facile de vous le procurer : il figure notamment en tête de chaque numéro du Bulletin des Parlers Normands. Il repose sur le double principe suivant :
Toute lettre transcrite se prononce.
Chaque lettre a sa valeur phonique propre.
Je me tiens d'ailleurs à la disposition des personnes qui désireraient, à cet égard, de plus amples éclaircissements.
Les communications portant sur la phonétique patoise et sur le lexique patois sont d'une infinie diversité. Elles auront trait soit aux modifications, très variables suivant les lieux, de chaque son latin pris comme point de départ, soit au relevé méthodique des termes techniques de la langue des ouvriers de la campagne, des termes de la flore et de la faune populaires, des noms de saints, des noms de lieux et je suis loin d'avoir énuméré toutes les parties d'un programme chargé.
Pour l'exécution de ce programme, je fais appel, Messieurs, à votre zèle scientifique ; je sollicite toute votre ardeur de bons patriotes normands, qui savez retrouver jusque dans la langue chaude et colorée du paysan de notre terre quelque chose de sa race et de son esprit.
Après avoir été les herboristes patients de cette luxuriante végétation, nous devons songer à en devenir les géographes appliqués. Après avoir relevé, pour chaque village, pour chaque agglomération, un certain nombre de formes caractéristiques-, nous recherchons suivant quelles lois, suivant quels hasards linguistiques ces formes se distribuent sur le territoire de l'ancienne province.
Pour parvenir à ce résultat, nous consacrons à chaque mot une carte, sa carte d'identité linguistique. Si, sur l'étendue du pays défriché, ce mot se présente sous trois formes différentes, nous convenons d'une couleur spéciale pour chacune de ces formes, rouge, bleu, jaune, par exemple, et nous teintons en rouge, en bleu ou en jaune, suivant les cas, chacune des régions où auront été relevées respectivement chacune de ces formes.
Or, nous sommes amenés à remarquer, en jetant un coup d'œil sur ces cartes linguistiques, la surprenante régularité avec laquelle se distribuent ces teintes ou, comme on dit, ces différentes aires phonétiques. Nous en concluons que ces régions ou aires constituent, par rapport à tel phénomène, autant de sous-patois distincts, — derniers vestiges décentres linguistiques autrefois puissants, aujourd'hui battus en brèche par les entreprises, sans cesse plus pressantes, de la langue des villes. Souvent aussi, un groupe restreint de deux, de trois communes, présentant un usage distinct de l'usage des alentours, émergera, — en manière d'îlot phonétique ou d'affleurement — comme témoin de la présence ancienne d'une aire phonétique étendue et que le flot envahissant du français est près de recouvrir entièrement.
Il pourra se faire, d'ailleurs, qu'une aire phonétique, dans l'indépendance de son développement, vienne à dépasser les limites des provinces que nous nous serons assignées. Il n'importe. Bornons-nous à ces limites qui, pour être parfois, comme on le voit, conventionnelles, ont au moins le grand mérite de bien préciser la besogne accomplie. Au-delà de ces limites, d'autres chercheurs, se livrant au même travail, seront un jour ou l'autre en état de raboutir leurs matériaux et les nôtres, et c'est ainsi que, de proche en proche, tout le sol linguistique gallo-roman se trouvera défriché.
Ce jour-là, nous verrons s'épanouir dans un atlas linguistique général toutes les richesses de la langue populaire en sa pittoresque diversité.
C'est un travail, dites-vous, qui dépasse les forces humaines. Non, Messieurs. J'ai dit déjà qu'il impliquait sans doute l'active collaboration d'une armée de travailleurs. Mais je ne crois pas avoir fait en vain appel au concours des Normands, de tous les Normands de bonne volonté. Je recevrai toujours avec plaisir toutes les communications qui seront adressées au Bulletin des Parlers Normands. C'est là qu'elles sont centralisées, en attendant l'heure de la synthèse ; c'est là qu'elles sont insérées et suivies, s'il y a lieu, de commentaires et d'éclaircissements.
Veuillez, en outre, considérer que mes recherches et enquêtes personnelles sur place ont porté, en une seule année, sur près de 200 communes du département du Calvados, les régions de Caen, de Falaise et de Honfleur, dont les cartes linguistiques sont déjà dressées conformément aux principes que je vous exposais tout à l'heure. Le tour de l'Orne viendra, puis de la Manche et de la Seine-Inférieure et de l'Eure, et je me plais à entrevoir le moment où— Dieu aidant — je serai en mesure d'établir enfin et de présenter au public savant l'Atlas Dialectologique de Normandie.
Lecture est donnée d'une lettre de M. de Marsy qui se préoccupe de cette question. Il pense que ceux qui veulent entreprendre de semblables travaux doivent se borner à s'inspirer de recherches comme celles de Gustave Le Vavasseur, ou celles, plus récentes, de M. Dottin, sur le Bas-Maine, et il engage les travailleurs à se garder de deux tendances qui ne se font que trop jour dans des publications récentes comme le Glossaire du pays de Mouzon, publié dans la Revue de Champagne, etc.
La première est de comprendre dans un glossaire patois des mots qui ne sont que de mauvaises prononciations de mots français qui figurent non seulement dans Littré, mais même dans le dictionnaire de l'Académie.
La deuxième est d'introduire dans les glossaires patois des termes absolument modernes, empruntés à l'argot parisien, à la langue verte pour lui donner son nom, et au vocabulaire des soldats d'Afrique ou des Colonies. Ces expressions empruntées au sabir, à l'idiome maltais parlé sur les bords de la Méditerranée, ne doivent nullement prendre place dans des glossaires locaux, comme ceux dont on se propose avec raison de poursuivre la rédaction.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par cgs611 le 25 Février 2021 à 15:46
Les manoirs du Perche : d'une image littéraire à la réalité archéologique
Elisabeth Desvaux-Marteville
Archéologie médiévale Année 1973
lien persee cliquez sur image bonne lecture
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Fier d’être Normand