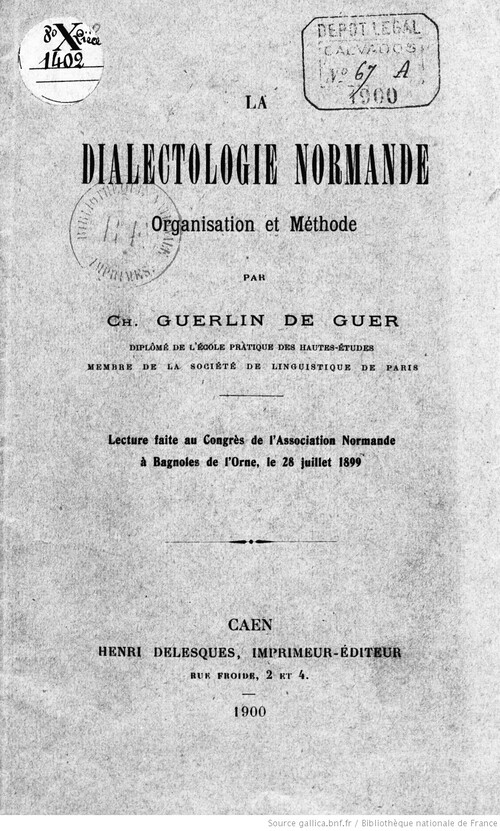-
LA DIALECTOLOGIE NORMANDE
LA DIALECTOLOGIE NORMANDE
Par GUERLIN DE GUER, Charles (1871-19..) : La Dialectologie normande : Organisation et méthode (1899)
Saisie du texte :
Messieurs,
Qu'est-ce, au vrai, qu'un patois ; et qu'est-ce que le patois normand ?
Quelles sont, en matière de patois, les recherches qui peuvent être le plus légitimement conseillées et favorisées ; à quelles règles de méthode convient-il de s'astreindre au cours de ces recherches, ainsi que dans les travaux ultérieurs dont elles seront l'occasion et l'objet ?
Tels sont les trois points que je me propose de développer très brièvement devant vous.
Nul de vous n'ignore, Messieurs, que les armées romaines ont importé sur notre sol gaulois, entre autres produits latins, leur propre langue, — langue de soldats et langue de marchands à la suite — fort éloignée, sans doute, de celle qu'écrivait, de celle même que parlait un César ou un Cicéron, langue vulgaire, en un mot, qui demeurait, toutefois, bien latine dans son esprit et dans sa teneur générale. Il est intéressant d'examiner quel fut le sort de cet idiome à compter du jour où, violemment arraché à son domaine de développement naturel, il se sentit en contact avec maints parlers divers, d'une origine essentiellement étrangère.
Qu'advint-il de cette végétation exotique transplantée dans une terre qui n'avait pas été préparée à la recevoir ? Il faut bien admettre que cette terre contenait toutes les propriétés utiles à la vie de l'étrangère, puisque celle-ci ne tarda pas non seulement à s'acclimater, mais encore à pousser en tous sens de robustes rejetons.
Toute langue étant un organisme sans cesse en évolution, sans cesse en travail, il va sans dire que le latin vulgaire, introduit en Gaule, ne devait pas, ne pouvait pas demeurer stationnaire. Il se modifia par voie de déformations successives et insensibles, tant et si bien qu'au bout de quelques siècles, il donnait déjà comme la sensation d'une langue nouvelle.
A cette langue, d'ailleurs très éloignée de la perfection, il manquait une qualité maîtresse : l'unité. Rayonnant de toutes parts, sur toute l'étendue du pays, exerçant l'influence de ses flexions et de son esprit jusque dans les villages les plus retirés, le latin vulgaire avait donné naissance à autant de parlers qu'il rencontrait de centres favorables à son développement, et provoqué autant de combinaisons linguistiques, autant de croisements différents. Les deux éléments composants — l'élément latin et l'élément indigène — étant, eux-mêmes, respectivement très variables, chacun des composés devait conserver sa marque propre d'origine, et il la conserva longtemps.
Toutefois, la nécessité d'élargir le cercle des rapports sociaux força les représentants d'un certain nombre de groupements d'adopter une langue compréhensible à chacun d'entre eux. C'est ainsi que, non sans quelque peine au début, tous les habitants d'une province se comprirent entre eux, tout en restant fidèles, chacun chez soi, aux particularités caractéristiques de leurs parlera locaux. A la période première de confusion succéda donc une période d'unification partielle.
Cette unification partielle s'étendit à la langue écrite après s'être exercée sur la langue orale ; chaque province eut sa langue écrite, autrement dit chaque province eut son dialecte : ce furent les dialectes écrits en Picardie, en Bourgogne, en Normandie ou dialectes picard, bourguignon, normand. Je n'ai pas à faire, ici, l'histoire de ces dialectes ; je rappelle seulement combien brillante fut celle de notre dialecte normand.
Cependant, la langue écrite dans la province de l'Ile-de-France parut, d'assez bonne heure, appelée à une destinée que rien dans sa constitution propre n'avait laissé prévoir.
A la faveur d'un concours de circonstances politiques sur lesquelles je n'ai pas à insister, le dialecte de l'Ile de France eut tôt fait d'éclipser ses voisins. La substitution de ce dialecte à tous les autres fut tellement prompte et complète qu'au XIVe siècle il n'y eut plus ni dialecte champenois, ni dialecte picard, ni dialecte normand, mais un seul dialecte, le dialecte français, et l'on peut dire qu'une seule langue, la langue française.
Dans la grande débâcle des dialectes, les parlers étaient restés indemnes, toujours vivants dans leur infinie diversité. Il n'y eut plus de dialecte champenois, picard, normand ; il y eut toujours un parler champenois, picard, normand ; et si des années ont suffi au dialecte de l'Ile de France pour imposer sa suprématie aux autres langues écrites de ce côté-ci de la Loire, des siècles ne suffirent pas au parler de l'Ile de France pour triompher de ses voisins, les parlers locaux.
Ces parlers, malgré le travail incessant, malgré l'action lente et destructive de l'influence française, ont trouvé, dans leur constitution propre, une force suffisante pour lutter avantageusement ; ils présentent, encore aujourd'hui, tout un ensemble de phénomènes qui les signalent et les recommandent à l'attention et aux recherches des linguistes. Ils valent d'être étudiés comme autant de survivants de langues autrefois autonomes ; ils sont les héritiers directs des langues parlées il y a huit siècles, et des langues écrites sur l'étendue de chacune de nos anciennes provinces ; ils sont, par suite, les frères, disons plus exactement les frères cadets de notre langue française moderne.
Qu'est-ce à dire, Messieurs ? Les patois ne sont donc pas ce qu'en a fait longtemps l'opinion commune.
« Le peuple de l'arrondissement, dit, en 1812, le sous-préfet de Domfront, ne parle point un dialecte particulier, ni un patois distinct. Seulement il prononce mal les mots, et les dénature en partie ; il dit, par exemple, coutia, tonia, tru, rote... Comme le défaut de prononciation ne peut servir à expliquer d'anciens usages, ... à donner la clef des chartes et autres documents historiques, j'ai pensé, ajoute l'honorable fonctionnaire, qu'il était inutile de vous faire part de la mauvaise prononciation du peuple ».
Qu'il soit possible, Messieurs, de relever à peu près autant d'erreurs que de mots dans une appréciation linguistique et surtout dialectologique datant de près de 90 ans, voilà qui ne saurait nous étonner ; mais prenez garde qu'une fraction importante du grand public en est restée au jugement de M. le Sous-Préfet de Domfront. Pour ma part, je ne compte plus les occasions où il m'a été donné d'entendre raisonner de pareille sorte sur la valeur et sur la nature des patois. Les mots français sortent dénaturés, dit-on, de la bouche du peuple. Si le peuple dit coutia pour « couteaux », tonia pour « tonneaux », tru pour « truie », rote pour « route », autant de défauts de prononciation, autant d'exemples d'un français écorché dont les paysans ont le monopole.
La théorie compte encore trop d'adeptes convaincus pour qu'il soit superflu de la réfuter. Après ce qui a été dit, d'ailleurs, la réfutation ne sera ni longue, ni malaisée.
Puisqu'il est reconnu que les patois sont frères et non descendants du français et que l'évolution des sons patois s'est opérée parallèlement à celle des sons français, il est difficile de voir dans les uns autant de déformations des autres. Un patois qui serait sorti de toutes pièces du français moderne impliquerait déformation de ce français, et, semblablement, il est légitime de reconnaître, dans les langues romanes primitives, autant de déformations différentes du latin, — celui-ci étant la souche commune de toutes celles-là — de reconnaître, au même titre, dans les patois de France, des déformations particulières de ce même latin, mais non du français. Qu'on n'aille pas dire qu'aujourd'hui du moins, quand tel mot moderne récemment créé pénètre dans le lexique du paysan, il y subit une déformation. Il se modifie, sans doute, mais en se conformant aux lois phonétiques du patois où il pénètre, et dans cette mesure seulement.
Et, bref, le patois normand n'est pas du français déformé, mais bien de l'ancien normand modifié. Là où le français dit « route », le normand moderne dit rote, et le normand du XIIe siècle le disait et l'écrivait déjà ; là où le français dit « truie », le normand moderne dit tru, c'est une forme dialectale dont les analogues se relèvent dans les mss. anglo-normands. Comment, à ce compte, soutiendra-t-on valablement que la connaissance de ces particularités n'est pas capable de nous donner la clef des chartes ? Les érudits en jugent autrement aujourd'hui, et ils demandent précisément au patois l'explication de formes relevées dans ces chartes, et que le français est parfois impuissant à éclaircir.
L'étude du patois en tant qu'auxiliaire de la philologie romane, l'étude aussi du patois considéré en lui-même a donné naissance à une science connue sous le nom de Dialectologie.
Quelles sont les recherches de dialectologie normande qui peuvent être les plus légitimement recommandées ; quelle méthode observer dans ces recherches ? Tels sont les deux points qui me restent à examiner.
Il faut partir du fait suivant qui n'échappe à aucun de vous, Messieurs, à savoir que les patois présentent, sur l'étendue d'une seule province, des différences sensibles, puisqu'ils varient de canton à canton, souvent même, par quelque côté, de village à village.
De quelle utilité vraie sont donc ces lourds et imposants in-folios où maint esprit chercheur a prétendu nous présenter l'image du patois d'une province tout entière, d'un département, voire d'une région moins étendue encore ?
De tels répertoires supposent, sans doute, une somme de recherches souvent considérable ; ils méritent d'être feuilletés pour le trésor des mots qui y sont renfermés. Ils ne sauraient, toutefois, fournir de matériaux propres à l'étude de l'évolution phonétique des patois ; à l'étude de la distribution topographique de ce patois ; à l'étude de l'influence française.
Tout dictionnaire du patois d'une province, d'un département, d'un canton, a ce défaut capital de nous renseigner non pas sur les parlers de toute cette province, ou de tout ce département, mais sur le parler d'un village-type arbitrairement érigé en représentant de tout un domaine linguistique. Autant le donner pour ce qu'il est réellement, je veux dire pour le glossaire d'un village. Nous n'aurons pas ainsi l'illusion d'une tâche achevée alors qu'elle est seulement à l'état d'ébauche, et chacun y trouvera son compte.
« Il faudrait, a dit M. Gaston Paris, que chaque commune, d'un côté, chaque son, chaque forme, de l'autre, eût sa monographie, purement descriptive, faite de première main et tracée avec toute la rigueur d'observation qu'exigent les sciences naturelles ».
Voilà donc une première catégorie de recherches bien capable de tenter le zèle et l'esprit d'observation des amateurs et des lettrés, de ceux, surtout, que leurs fonctions ou leurs goûts ont retenus longtemps à la campagne et qui se sont rendu familiers les sons patois, pour en avoir eu l'oreille constamment frappée. Que si la confection d'un glossaire leur parait une tâche ou trop aride ou de trop longue haleine, ils se contenteront de notes d'une courte étendue qui pourra porter sur de multiples sujets.
Partant toujours du parler d'un seul village ou, plus exactement, d'un groupement social bien limité, ils y étudieront les particularités de la grammaire ou de la syntaxe patoise, ils en relèveront les particularités phonétiques les plus remarquables, les plus caractéristiques.
C'est à l'examen phonétique, c'est-à-dire à l'examen des sons dans leur évolution tantôt régulière, tantôt tourmentée, et jusque dans les nuances les plus insensibles que nous sommes ramenés de toutes parts. Tout travail approfondi portant sur ce sujet suppose au moins quelque connaissance générale de l'histoire des sons dans leur passage du latin au français moderne et, parallèlement, au patois de nos jours.
Afin de faire profiter le plus grand nombre du résultat de ces recherches, afin d'introduire l'unité nécessaire dans ces études et de préparer les synthèses ultérieures, il conviendra d'adopter un système de transcription de sons qui soit moins défectueux, moins décevant, qui présente une image plus sincère des sons que ne le ferait notre orthographe française moderne.
La transcription des sons patois a toujours été la pierre d'achoppement des dialectologues. Il n'est pas sans intérêt de remarquer que, de tous les travaux sérieux entrepris en matière de patois, pas un seul n'est antérieur à l'époque, — rapprochée de nous — où les patoisants se sont astreints à une notation méthodique et rationnelle des sons.
L'alphabet le plus répandu — il me parait d'ailleurs être d'un maniement aisé et n'exiger qu'un court apprentissage — fut adopté et éprouvé par les directeurs et rédacteurs de la Revue des Patois gallo-romans pendant ses sept années d'existence. Il vous sera facile de vous le procurer : il figure notamment en tête de chaque numéro du Bulletin des Parlers Normands. Il repose sur le double principe suivant :
Toute lettre transcrite se prononce.
Chaque lettre a sa valeur phonique propre.
Je me tiens d'ailleurs à la disposition des personnes qui désireraient, à cet égard, de plus amples éclaircissements.
Les communications portant sur la phonétique patoise et sur le lexique patois sont d'une infinie diversité. Elles auront trait soit aux modifications, très variables suivant les lieux, de chaque son latin pris comme point de départ, soit au relevé méthodique des termes techniques de la langue des ouvriers de la campagne, des termes de la flore et de la faune populaires, des noms de saints, des noms de lieux et je suis loin d'avoir énuméré toutes les parties d'un programme chargé.
Pour l'exécution de ce programme, je fais appel, Messieurs, à votre zèle scientifique ; je sollicite toute votre ardeur de bons patriotes normands, qui savez retrouver jusque dans la langue chaude et colorée du paysan de notre terre quelque chose de sa race et de son esprit.
Après avoir été les herboristes patients de cette luxuriante végétation, nous devons songer à en devenir les géographes appliqués. Après avoir relevé, pour chaque village, pour chaque agglomération, un certain nombre de formes caractéristiques-, nous recherchons suivant quelles lois, suivant quels hasards linguistiques ces formes se distribuent sur le territoire de l'ancienne province.
Pour parvenir à ce résultat, nous consacrons à chaque mot une carte, sa carte d'identité linguistique. Si, sur l'étendue du pays défriché, ce mot se présente sous trois formes différentes, nous convenons d'une couleur spéciale pour chacune de ces formes, rouge, bleu, jaune, par exemple, et nous teintons en rouge, en bleu ou en jaune, suivant les cas, chacune des régions où auront été relevées respectivement chacune de ces formes.
Or, nous sommes amenés à remarquer, en jetant un coup d'œil sur ces cartes linguistiques, la surprenante régularité avec laquelle se distribuent ces teintes ou, comme on dit, ces différentes aires phonétiques. Nous en concluons que ces régions ou aires constituent, par rapport à tel phénomène, autant de sous-patois distincts, — derniers vestiges décentres linguistiques autrefois puissants, aujourd'hui battus en brèche par les entreprises, sans cesse plus pressantes, de la langue des villes. Souvent aussi, un groupe restreint de deux, de trois communes, présentant un usage distinct de l'usage des alentours, émergera, — en manière d'îlot phonétique ou d'affleurement — comme témoin de la présence ancienne d'une aire phonétique étendue et que le flot envahissant du français est près de recouvrir entièrement.
Il pourra se faire, d'ailleurs, qu'une aire phonétique, dans l'indépendance de son développement, vienne à dépasser les limites des provinces que nous nous serons assignées. Il n'importe. Bornons-nous à ces limites qui, pour être parfois, comme on le voit, conventionnelles, ont au moins le grand mérite de bien préciser la besogne accomplie. Au-delà de ces limites, d'autres chercheurs, se livrant au même travail, seront un jour ou l'autre en état de raboutir leurs matériaux et les nôtres, et c'est ainsi que, de proche en proche, tout le sol linguistique gallo-roman se trouvera défriché.
Ce jour-là, nous verrons s'épanouir dans un atlas linguistique général toutes les richesses de la langue populaire en sa pittoresque diversité.
C'est un travail, dites-vous, qui dépasse les forces humaines. Non, Messieurs. J'ai dit déjà qu'il impliquait sans doute l'active collaboration d'une armée de travailleurs. Mais je ne crois pas avoir fait en vain appel au concours des Normands, de tous les Normands de bonne volonté. Je recevrai toujours avec plaisir toutes les communications qui seront adressées au Bulletin des Parlers Normands. C'est là qu'elles sont centralisées, en attendant l'heure de la synthèse ; c'est là qu'elles sont insérées et suivies, s'il y a lieu, de commentaires et d'éclaircissements.
Veuillez, en outre, considérer que mes recherches et enquêtes personnelles sur place ont porté, en une seule année, sur près de 200 communes du département du Calvados, les régions de Caen, de Falaise et de Honfleur, dont les cartes linguistiques sont déjà dressées conformément aux principes que je vous exposais tout à l'heure. Le tour de l'Orne viendra, puis de la Manche et de la Seine-Inférieure et de l'Eure, et je me plais à entrevoir le moment où— Dieu aidant — je serai en mesure d'établir enfin et de présenter au public savant l'Atlas Dialectologique de Normandie.
Lecture est donnée d'une lettre de M. de Marsy qui se préoccupe de cette question. Il pense que ceux qui veulent entreprendre de semblables travaux doivent se borner à s'inspirer de recherches comme celles de Gustave Le Vavasseur, ou celles, plus récentes, de M. Dottin, sur le Bas-Maine, et il engage les travailleurs à se garder de deux tendances qui ne se font que trop jour dans des publications récentes comme le Glossaire du pays de Mouzon, publié dans la Revue de Champagne, etc.
La première est de comprendre dans un glossaire patois des mots qui ne sont que de mauvaises prononciations de mots français qui figurent non seulement dans Littré, mais même dans le dictionnaire de l'Académie.
La deuxième est d'introduire dans les glossaires patois des termes absolument modernes, empruntés à l'argot parisien, à la langue verte pour lui donner son nom, et au vocabulaire des soldats d'Afrique ou des Colonies. Ces expressions empruntées au sabir, à l'idiome maltais parlé sur les bords de la Méditerranée, ne doivent nullement prendre place dans des glossaires locaux, comme ceux dont on se propose avec raison de poursuivre la rédaction.
 Tags : patois, langue, francais, dialecte, normand
Tags : patois, langue, francais, dialecte, normand
-
Commentaires
Fier d’être Normand